Formation, certification et normes : les piliers de l'énergie solaire résidentielle au Québec
Comment assurer l'avenir solaire du Québec

Après un premier article où nous avons abordé la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie solaire québécoise, actuelle et à venir, il est temps de parler de structure.
Et cette structuration repose sur trois piliers essentiels : la formation, la certification et les normes.
Mais avant d'explorer ces solutions, il faut comprendre pourquoi structurer le marché est essentiel et ce qu’un manque de préparation pourrait entraîner.
Les conséquences d’une croissance solaire sans contrôle
Lorsqu’un marché se développe trop rapidement, sans garde-fous, les conséquences peuvent être lourdes.
D’abord sur le plan technique : une installation solaire mal conçue ou mal réalisée peut, au mieux, fonctionner partiellement ou de manière inefficace. Au pire, elle peut engendrer des risques d’incendie mettant en péril la sécurité des personnes.
Ajoutons à cela de fausses promesses de rendement, des installations vendues à deux ou trois fois leur coût réel par des vendeurs peu scrupuleux, et l’on obtient un cocktail explosif pour une industrie naissante.
Il ne faudra pas longtemps avant que les médias s’emparent de ce sujet. Même si cela ne concerne qu’un seul projet sur mille, ce sera celui dont tout le monde parlera sur les réseaux sociaux. Et dans l’opinion publique, il n’y aura aucune distinction entre les entreprises sérieuses et les fraudeurs.
Croyez-moi, pour avoir vécu cela en France, il est très difficile de redorer l’image d’un secteur après coup. Tenter d’expliquer, d’éduquer, de nuancer prend des années. L’opinion est vite faite, la confiance longue à regagner.
Il est donc essentiel de protéger les consommateurs contre les pratiques douteuses, voire illégales. Car ces dérives peuvent conduire des ménages à s’endetter sur de longues périodes, voire à perdre les économies d’une vie, en se basant sur des promesses de production aussi séduisantes qu’irréalistes.
Et malheureusement, le Québec a actuellement une cible dans le dos. Pourquoi ? Parce que le marché solaire aux États-Unis s’effondre. Son président est en train de défaire dix ans de progrès avec sa Big Beautiful Bill. Résultat : une vague de vendeurs sans scrupules va se retrouver sans emploi et chercher de nouveaux territoires. Devinez qui est frontalier du Vermont ? Bingo !
Notre belle province est donc dans leur viseur. Et il ne s’agit pas seulement de vendeurs américains. D’autres viendront également d’ailleurs au Canada. L’Alberta, par exemple, qui a connu l’un des plus forts développements solaires ces dernières années, commence déjà à faire face à ces dérives.
Bon allez, après ce tableau peu réjouissant (mais nécessaire), la bonne nouvelle : il existe des solutions concrètes.
Former des installateurs compétents : une nécessité
Aujourd’hui, la réalité est simple. Le solaire est un métier. Avoir déjà posé un panneau sur le toit de son cousin ou installé un tableau électrique ne suffit pas.
Il faut maîtriser les bases théoriques de l’électricité photovoltaïque, savoir dimensionner un système, connaître les normes de sécurité, utiliser les bons outils (coucou Otonomi DX😅), et surtout faire preuve de rigueur.
Ces compétences ne s’improvisent pas. Elles doivent s’acquérir dans un cadre structuré. Cela soulève plusieurs questions. Quelle est la meilleure forme de formation ? Théorique ou pratique ? Longue ou courte ? En centre ou en entreprise ?
La réponse dépendra toujours du profil de la personne formée.
Une chose est certaine : il faut multiplier les formats pour répondre à des réalités variées. Des formations intensives pour les professionnels en reconversion. Des parcours plus longs pour les jeunes diplômés. Des modules spécifiques pour les régions éloignées.
Peu importe la durée ou l’endroit où la formation est offerte, il faudra une uniformisation des contenus.
Certaines formations existent déjà. Le CEGEP de Jonquière, Écohabitation, Stardust, CMEQ, Électricité Plus et BC énergies en sont quelques exemples. Mais elles restent isolées.
Il faudra développer de nouveaux programmes, en collaboration avec les professionnels de terrain, tout en les rendant accessibles géographiquement, financièrement et humainement.
La partie théorique peut être transmise en quelques jours pour ceux qui possèdent déjà des bases solides en électricité. En revanche, la pratique est essentielle. Installer un système solaire résidentiel implique une grande variété de tâches : percer une toiture, assurer l’étanchéité, raccorder les panneaux en courant continu, sécuriser le chantier, effectuer les branchements en courant alternatif avec l’onduleur et le tableau électrique du client, etc. Autant d’interventions que de risques.
La maîtrise de ces gestes peut prendre plusieurs mois. Les formations devront donc intégrer un volet pratique en conditions réelles.
Et puisque le Québec est dans une situation où la demande dépasse largement l’offre, pourquoi ne pas créer des passerelles entre les nouveaux installateurs en formation et les entreprises déjà établies, qui cherchent de la main-d’œuvre ? Je pose l’idée ici…
Reconnaître les compétences : la certification comme repère
Former, c’est bien. Mais comment un client peut-il savoir si l’installateur est vraiment compétent ?
C’est un point faible du marché québécois. Les particuliers manquent de repères.
Dans d’autres pays, des certifications reconnues ont permis de structurer l’offre. Aux États-Unis, le NABCEP garantit un niveau de compétence. En France, la certification QualiPV joue un rôle similaire.
Ces titres sont devenus des références, autant pour les clients que pour les institutions publiques. Dans certains cas, ils conditionnent même l’accès aux subventions.
Le Québec ne dispose pas encore de ces outils. Pourtant, il serait pertinent de créer une ou plusieurs certifications co-développées avec les acteurs du terrain, et reconnues par les instances gouvernementales et municipales.
Cela offrirait aux consommateurs un repère clair, tout en incitant les professionnels à se former sérieusement (mais ne vous en faites pas, certains travaillent déjà dessus😉).
Quand les normes peinent à suivre le terrain
Au-delà de la formation et de l’identification claire des acteurs, un dernier élément est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du secteur solaire résidentiel : les normes.
Le programme de mesurage net d’Hydro-Québec, qui permet aux clients de revendre leur surplus d’énergie solaire au réseau, existe depuis 2006. Pourtant, à ce jour, moins de 900 projets solaires résidentiels y ont été raccordés. À l’époque, une série de normes connues sous les codes E.12-01 à E.12-09 existait techniquement, mais elles étaient vagues, incomplètes et laissaient souvent place à l’interprétation, s’en remettant largement au bon jugement des professionnels sur le terrain.
Les choses ont changé à la fin de l’année 2024 car ces normes ne correspondaient plus aux nouvelles technologies disponibles sur le marché, lorsqu'elles ont été mises à jour, avec des conséquences à la fois positives et problématiques.
Commençons par les points positifs : les nouvelles normes offrent désormais un cadre plus clair, spécifiquement adapté au solaire résidentiel au Québec. Elles abordent des enjeux essentiels de sécurité, notamment en ce qui concerne l’interaction des onduleurs résidentiels avec le réseau public ainsi que la protection des techniciens lors de l’installation et de la maintenance.
Mais cette mise à jour a aussi ses limites. Le nouveau code se concentre presque exclusivement sur la partie en courant alternatif, entre la résidence et le réseau, sans vraiment encadrer la partie en courant continu, celle qui concerne les panneaux solaires eux-mêmes. Or, ces deux types de courant nécessitent des approches de sécurité très différentes. Le code a également introduit de nouvelles exigences, comme l’ajout de dispositifs de transfert manuel et de coupure, alors que la plupart des onduleurs modernes intègrent déjà ces fonctions par conception.
La publication de cette version révisée a suscité une forte réaction de la part de la communauté solaire. De nombreux professionnels ont dénoncé un manque de pertinence pratique sur le terrain et une hausse des coûts d’installation, principalement liée à l’ajout d’équipements obligatoires, ce qui réduit encore davantage la rentabilité pour les propriétaires. On estime ce surcoût entre 1 000 et 2 000 dollars par projet.
Cette situation met en lumière une fracture entre deux mondes professionnels qui doivent aujourd’hui collaborer : d’un côté, les installateurs issus du hors réseau, très expérimentés mais parfois marginalisés, et de l’autre, les électriciens certifiés, techniquement compétents mais souvent peu familiers avec les spécificités du solaire.
À l’avenir, ces normes devront évoluer. Cette évolution devra s’appuyer sur l’expérience concrète du terrain, et certains professionnels collaborent déjà avec Énergie Solaire Québec et Hydro-Québec pour mieux aligner la réglementation sur la réalité des chantiers. Pour rappel, aujourd’hui, seul un maître électricien est habilité à installer et mettre en service la partie AC.
Contrôle de conformité : le maillon manquant
Donc, les installateurs sont formés, les particuliers peuvent s’y retrouver grâce aux certifications professionnelles, et des normes électriques, même encore imparfaites, existent pour garantir la sécurité. Mais il manque une pièce centrale : personne ne vérifie réellement que tout cela est respecté sur le terrain.
Une fois l’installation solaire complétée,le maître électricien valide la conformité de son ouvrage. Mais rien ne garantit que le professionnel a réellement suivi les règles de l’art. Ce qui laisse la porte ouverte à des erreurs, des oublis, ou même à des pratiques risquées.
De mon expérience en France, une bonne pratique serait de ne pas activer la centrale immédiatement après la fin du chantier, mais plutôt de déclarer l’achèvement des travaux auprès d’un organisme de contrôle indépendant, agréé par Hydro-Québec, qui effectuerait une inspection sur place. Ce n’est qu’après avoir reçu une validation conforme que la mise en service pourrait être officialisée auprès d’Hydro-Québec.
Et pas besoin d’aller jusqu’en France. Ce fonctionnement existe déjà en Ontario, avec l’Electrical Safety Authority (ESA), qui inspecte et certifie chaque projet avant connexion au réseau.
Des signaux encourageants
On vient de le voir : tout n’est pas parfait, mais des dynamiques positives émergent.
Énergie Solaire Québec collabore activement avec Hydro-Québec depuis plusieurs mois. L’organisation sert de lien essentiel entre le terrain et la société d’État, en relayant les réalités vécues par les installateurs et en partageant l’état d’avancement des discussions. Ce dialogue permet à Hydro-Québec d’adapter ses normes aux réalités du terrain. En parallèle, plusieurs professionnels du secteur travaillent conjointement à l’établissement d’une liste exhaustive des onduleurs et batteries solaires compatibles avec les futures exigences réglementaires.
Par ailleurs, Énergie Solaire Québec a récemment mis sur pied un groupe de travail dédié aux enjeux de formation.
Ce groupe réunit à la fois des organismes académiques publics et privés, ainsi que des représentants du milieu professionnel. Leur mission : analyser ce qui se fait ailleurs dans le monde, anticiper les besoins de la province, et réfléchir à un cadre structurant pour les formations à venir, celles qui façonneront les professionnels de demain.
Ces initiatives témoignent clairement d’une volonté d’organisation et de la structuration progressive d’un nouveau marché.
En résumé, la formation et la certification ne sont pas de simples options pour un secteur en pleine éclosion. Elles sont les conditions mêmes de sa survie.
Le Québec ne réussira son virage solaire que si ses professionnels sont prêts, compétents (et ils le sont déjà, merci au marché hors-réseau😛) et reconnus.
Cela exige un effort collectif, impliquant institutions, centres de formation, entreprises et représentants du secteur. Cela suppose aussi de tirer des leçons des expériences étrangères. Non pas pour les copier, mais pour éviter les erreurs déjà commises.
Il faudra que tous les acteurs soient au rendez-vous de l’histoire. Car seule l’unité et l’intelligence collective garantiront la vie (ou la mort) d’un marché dont nous avons tous désespérément besoin.
Dans le prochain article, nous parlerons du nerf de la guerre : les subventions.

.png)
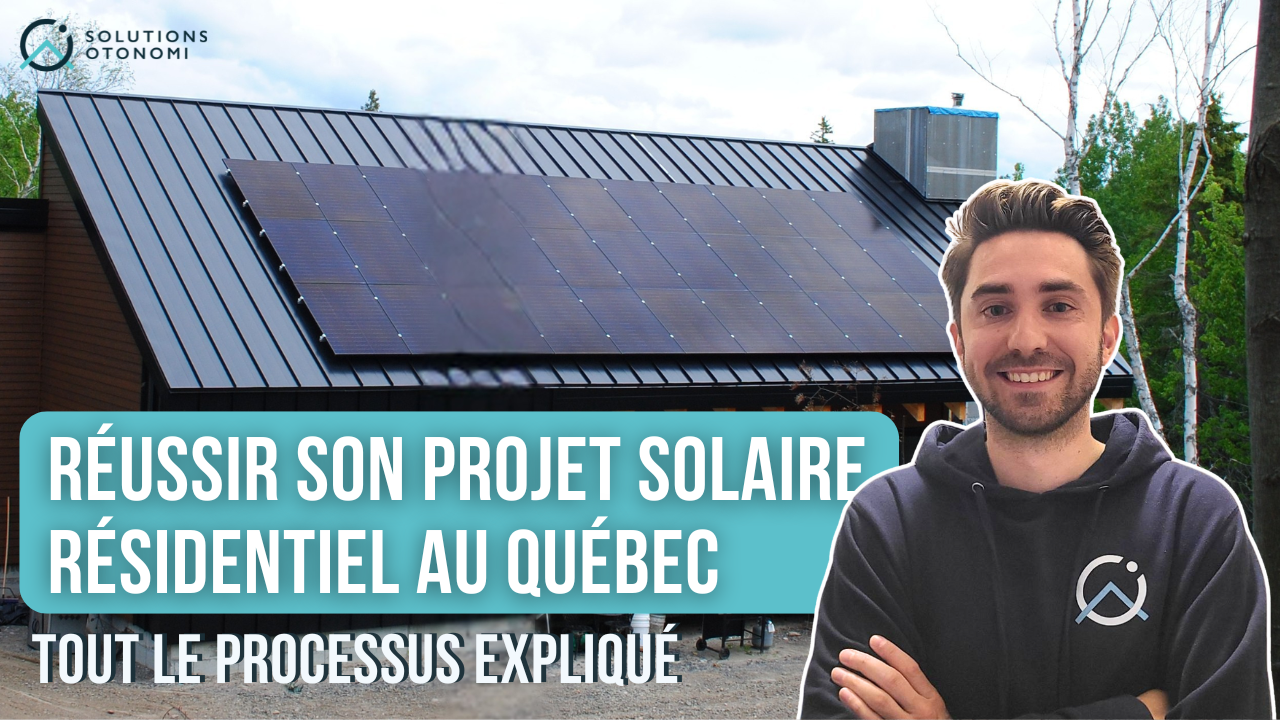

.png)